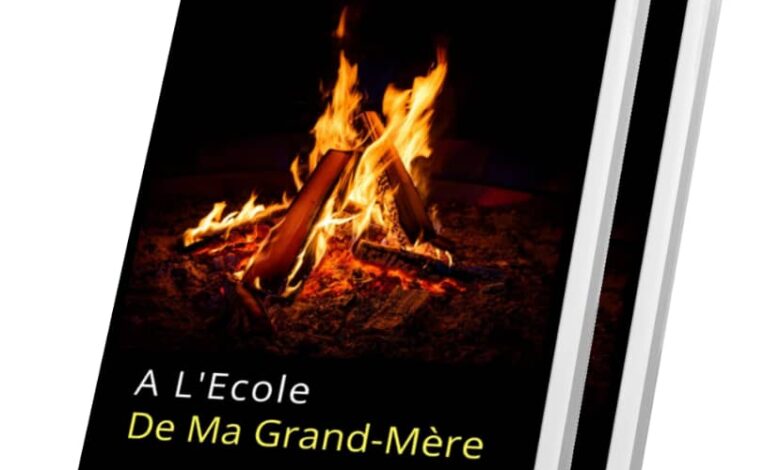
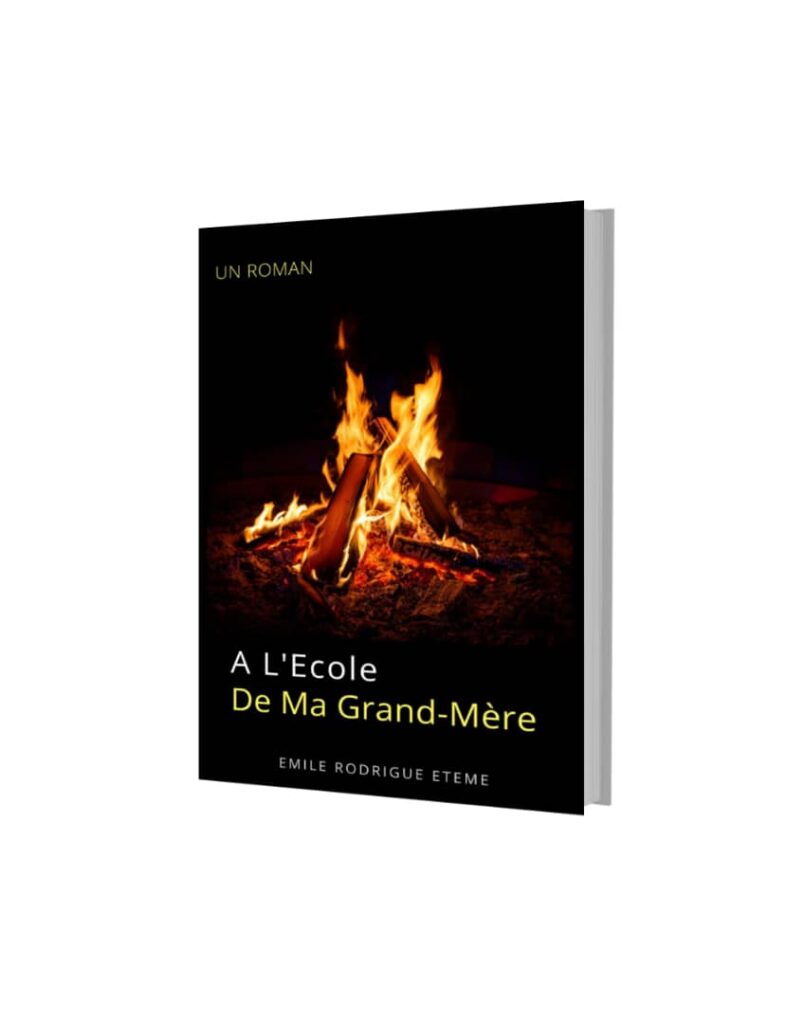
RÉSUMÉ DE L’ŒUVRE
À l’École de ma grand-mère est un roman profondément ancré dans la culture camerounaise et la tradition africaine, où la sagesse populaire transmise oralement d’une génération à l’autre occupe une place centrale. Le récit met en scène Mammy, une grand-mère à la fois tendre, lucide et pleine de verve, qui sert de guide spirituel, moral et affectif à ses petits-enfants, notamment Rosalie, une jeune femme en crise conjugale. À travers les dialogues riches, les proverbes savoureux, les récits de vie et les scènes de la vie quotidienne, Mammy enseigne avec patience l’art de vivre en famille, l’amour, le pardon, la résilience et la puissance des liens communautaires.
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
Ce roman se lit à la fois comme une chronique familiale et comme un traité vivant de sagesse africaine. Loin d’un simple récit de conflit conjugal, il devient un miroir tendu à la société contemporaine, confrontée à la modernité, aux blessures silencieuses, à la perte de repères, mais aussi à la quête de réconciliation et de vérité. L’écriture est fluide, chaleureuse, ponctuée d’expressions locales et de scènes à la fois comiques et poignantes.
L’auteur réussit le pari d’allier narration et transmission, ancrage local et portée universelle. Il donne voix aux anciens sans figer le passé, et aux jeunes sans juger leur désorientation. Le rythme du récit, vivant et bien construit, est porté par des personnages hauts en couleur, comme Mammy, Rosalie, Zembla ou encore Hervé, qui incarnent chacun une facette des tensions et richesses de la société africaine actuelle.
THÈMES ABORDÉS
Transmission intergénérationnelle : Le cœur de l’œuvre repose sur la parole de Mammy, symbole de mémoire et de pédagogie affective.
Famille et mariage : À travers le couple de Rosalie et Hervé, le roman aborde la complexité des relations conjugales, les malentendus, l’influence des tiers, et l’importance du dialogue.
Violence et réconciliation : Le passage de la violence à la paix, notamment à travers le personnage de Zembla, illustre une critique des réactions impulsives et une invitation à la médiation traditionnelle.
Sagesse populaire africaine : Proverbes, anecdotes, rites de palabres, tout dans le texte valorise les ressources culturelles africaines comme outils de gestion des conflits.
Rôle de la communauté : Le roman montre que la résolution des conflits conjugaux ne se limite pas à la sphère privée, mais mobilise souvent tout un réseau familial et villageois.
STYLE ET STRUCTURE
L’auteur adopte un style narratif souple, souvent humoristique, mais toujours empreint de profondeur. Le récit progresse par scènes et dialogues, avec une alternance entre narration et prises de parole directes, ce qui donne au texte un rythme dynamique et un aspect très vivant, presque théâtral. L’oralité africaine s’y fait sentir dans chaque page, renforçant l’authenticité et la force évocatrice du récit.
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL
À l’École de ma grand-mère peut être lu à plusieurs niveaux : comme une œuvre littéraire, comme un manuel de sagesse culturelle, ou encore comme un outil d’éducation relationnelle et sociale. Il est particulièrement pertinent dans les cadres éducatifs, sociaux et pastoraux. Il interroge aussi les modèles familiaux et conjugaux contemporains, en proposant des pistes issues de la tradition sans tomber dans l’idéalisation.
CONCLUSION
Ce roman est une perle rare : à la fois enraciné et ouvert, intime et communautaire, dramatique et porteur d’espoir. Il rend hommage à nos grand-mères africaines, ces piliers silencieux de nos sociétés, détentrices d’une sagesse millénaire. En nous rappelant que la parole juste peut guérir, il nous convie à une école de vie où l’oralité, la bienveillance et l’écoute sont les premières leçons.
Une lecture essentielle pour quiconque veut comprendre les dynamiques familiales en Afrique et renouer avec l’art ancestral de la parole qui soigne.




